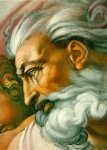Bonjour. Vous êtes sur une des pages présentant des extraits du livre :
Dieu est-il un gaucher qui joue aux dés ?
Histoire drôle, mais vraie, de la découverte de l'univers,
et des environs.
La barre de navigation bleue ci-dessus vous permet d'aller ou de retourner à l'accueil, ou d'aller directement vers d'autres extraits.
|
Du mythe à la physique.
Le changement, l'être, l'esprit, l'atome et
le hasard.
|
Les milésiens, philosophes de la nature.
Au début étaient les mythes...

Nous
imaginons aisément que lorsque les premiers hommes regardaient le
monde, tout devait leur sembler mystérieux et incompréhensible
: les étoiles dans le ciel, le déchaînement des orages,
la naissance d’un brin d’herbe ou d’une petite fleur, la maladie et la
mort... Nous croyons ingénument qu’ils étaient complètement désarmés
pour expliquer ces phénomènes inexplicables.
Et bien non! En réalité, rien de
tout cela ne leur posait problème. Il leur suffisait de prendre un
dieu de la pluie ici, une déesse de la moisson là, sans oublier
l’excellent Dionysos
[N1], et d’autres
encore, et le tour était joué, tout s’expliquait : les volcans
exhalaient le souffle d’Héphaïstos, Eole poussait les nuages
dans le ciel, les vagues de la mer enflaient ou s’apaisaient selon l’humeur
de Poséidon… et c’est Dionysos qui rendait la parole et le pas hésitants
lorsqu’on buvait son vin divin.
Les Grecs d’Homère vivaient dans la main des dieux ; pour eux,
le surnaturel… mais c’était naturel !
… Il l’est encore souvent aujourd’hui !
L’invention de la science.
Pourtant, en dépit de toutes ces "explications" si poétiques,
quelques hommes commencèrent à s’étonner. Lorsque
Aristote retracera l’histoire des penseurs qui l’avaient précédé,
il rendra hommage à cette vertu de l’étonnement chez eux :
" Ce fut en effet
l’étonnement qui poussa, comme aujourd’hui, les premiers penseurs
aux spéculations philosophiques. Au début, ce furent les
difficultés les plus apparentes qui les frappèrent ; puis,
s’avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à
résoudre des problèmes plus importants, tels les phénomènes
de la Lune, du Soleil, des étoiles, enfin la genèse de l’univers.
Apercevoir une difficulté et s’étonner, c’est reconnaître
sa propre ignorance... "
C’est ainsi qu’environ six siècles avant Jésus-Christ, la
philosophie naquit d’une manière soudaine à Milet
[N2],
lorsque Thalès, Anaximandre, Anaximène, se sont étonnés.
Ils se sont étonnés, et ils ont entrepris de tout expliquer
par la seule action d’éléments naturels - l’eau, l’air, la
terre, le feu… Quelle audace - ou peut-être quelle inconscience !
Il fallait en effet oser dire qu’il est possible d’expliquer les phénomènes
naturels sans faire appel aux dieux. Quelle drôle d’idée,
puisque le métier des dieux était, outre de charmer les humains
du récit de leurs exploits extraordinaires, leur métier était
- justement ! - d’expliquer l’inexplicable.
Et ils s’en tiraient d’ailleurs fort bien. Pourquoi vouloir les mettre
au chômage ?
Quoi qu'il en soit, les milésiens ont osé le faire ;
ils ont ainsi inventé la science !
Le " miracle grec ".
On a parlé du "miracle grec" à propos de cette révolution
intellectuelle. L’expression a le mérite de souligner la fantastique
avancée qui s’est faite à cette époque ; mais d’un
autre côté elle est plutôt mal venue, puisque le miracle
en question consistait - justement ! - à refuser de voir des miracles
partout !
On appelle les milésiens les "Philosophes de la nature", ou encore
les "physiciens". Ils furent en quelque sorte les premiers ingénieurs.
(...)
La fin des mythes?
(...)
Le changement, l'être, l'esprit, l'atome
et le hasard.
Les mythes, le retour!
(...)
De la physique vers la métaphysique - Pythagore.
(...)
Xénophane.
Du miel et des figues.
Xénophane aimait le miel et les figues ;
n’oublions pas que tout ceci se passait sous le ciel de la Méditerranée, que l'air embaumait de myrte et d'origan, de thym et de romarin, qu'il bruissait de la ronde des abeilles butineuses, et que la mer se chauffait à un soleil généreux ; c'est allongés sur le sable que les premiers astronomes ont observé le ciel… C'est en raison de son goût pour les fruits sucrés du soleil que Xénophane a ouvert un nouveau et très important thème de réflexion ; en constatant que « si Dieu n’avait pas créé le miel, les hommes trouveraient les figues bien plus sucrées » - il a en effet jeté le doute sur ce que nous voyons, ce que nous entendons... ; il disait de cette façon imagée que nos sensations varient selon le moment - selon que nous avons goûté du miel auparavant ou non ; elles varient également d’un observateur à l’autre, l’un trouvant chaude une eau - qu’un autre qui a de la fièvre, trouvera froide. Aujourd’hui encore, on enseigne aux élèves la relativité de nos sensations au moyen d’exemples de ce type.
Ainsi, à la question première des milésiens, "De quoi est fait le monde ?", Xénophane a ajouté cette nouvelle question, plus difficile encore : "Comment puis-je le savoir ?" Ou, plus généralement : "Comment puis-je savoir ?"
La figue et l’électron.
A première vue, la remarque de Xénophane ne semblait pas capitale. Après tout, il ne s’agissait que d’un peu d’eau, de miel, et de quelques figues, il n’y avait pas là de quoi déstabiliser la philosophie ! Pourtant, l’affaire était sérieuse : alors que les milésiens croyaient ingénument en ce qu’ils voyaient - Xénophane dénonçait les sens, la principale fenêtre par laquelle nous percevons le monde, l’accusant d’être équipée de vitres déformantes et de nous induire ainsi en erreur. Comment alors découvrir le monde ? Le doute de Xénophane n’a pas encore fini de ronger l’humanité ; on verra tout au long de ce livre les différentes réponses qui lui seront apportées.
Les sophistes se résigneront à la relativité
de la vérité.
Platon, Descartes, etc... se tourneront vers la raison, espérant
y trouver une vérité absolue, indépendante des sens.
Les empiristes continueront à
s’appuyer sur les sens malgré les doutes de Xénophane. Mais
ce n’est qu’avec la révolution scientifique du XVIIe
siècle qu’ils apprendront à en corriger les déformations
et les erreurs, en inventant l’expérience, plus exigeante que la
simple observation - associée à la mesure, plus objective
que la simple appréciation.
Et enfin, la mécanique quantique rouvrira la plaie
que l’on croyait guérie grâce à la méthode expérimentale.
La mécanique quantique montrera en effet que dans le monde de l’infiniment
petit, la réalité apparaît encore différente
selon la manière dont on l’observe : de la même façon
que la figue paraît plus ou moins sucrée selon ce que nous
avons mangé auparavant, de la même façon, l’électron
nous apparaît être une onde ou une particule selon la manière
dont on l’observe. Il en résulte de nouveaux débats quant
à l’existence d’une réalité objective, indépendante
de celui qui l’observe.
Des dieux et des hommes.
Xénophane exercera son esprit critique dans bien d'autres domaines, par exemple à l'égard des sportifs de haut niveau : “ Il n’est pas juste qu’un habile pugiliste, un valeureux athlète au pentathlon, à la course à pied, aient plus d’honneurs et de richesses que celui qui enseigne la sagesse. ”
Et pourtant, il ne connaissait ni le montant du transfert des joueurs de football, ni le salaire d’un prof de philo !
Il sera plus caustique encore lorsqu’il se penchera sur les croyances des hommes :
non seulement la connaissance des choses que
nos sens nous transmettent est incertaine, mais la connaissance que nous
avons des dieux est également douteuse. Xénophane, qui avait
été une sorte de barde, de troubadour, chantant les poèmes
d’Homère et d’Hésiode dans les banquets, avait en effet pris
conscience des difficultés que soulevait le comportement de ces
dieux, qui se permettaient tout ce qui est blâmé chez les
hommes : mentir, boire à l’excès, forniquer à tout
va, (surtout Zeus, chef des dieux, coureur de jupons en diable, connu pour
être un fin amateur de belles mortelles). Xénophane en avait
conclu que nous investissons une grande part de nous-mêmes dans
nos dieux, imaginant qu’ils ne sont que des sortes de "Superman", semblables
à nous, mais en mode super ; ayant une super-force, des super-joies,
des super-colères, des super-jalousies ; et tout aussi capables que Superman de prendre l'aspect d'un simple mortel, si nécessaire. Les poètes, Homère, Hésiode, étaient
grandement coupables en ce domaine, en colportant les savoureuses histoires
de la vie agitée des dieux - leurs colères, leurs frasques
amoureuses, les coquetteries des belles de l'olympe...
Xénophane, qui avait
été une sorte de barde, de troubadour, chantant les poèmes
d’Homère et d’Hésiode dans les banquets, avait en effet pris
conscience des difficultés que soulevait le comportement de ces
dieux, qui se permettaient tout ce qui est blâmé chez les
hommes : mentir, boire à l’excès, forniquer à tout
va, (surtout Zeus, chef des dieux, coureur de jupons en diable, connu pour
être un fin amateur de belles mortelles). Xénophane en avait
conclu que nous investissons une grande part de nous-mêmes dans
nos dieux, imaginant qu’ils ne sont que des sortes de "Superman", semblables
à nous, mais en mode super ; ayant une super-force, des super-joies,
des super-colères, des super-jalousies ; et tout aussi capables que Superman de prendre l'aspect d'un simple mortel, si nécessaire. Les poètes, Homère, Hésiode, étaient
grandement coupables en ce domaine, en colportant les savoureuses histoires
de la vie agitée des dieux - leurs colères, leurs frasques
amoureuses, les coquetteries des belles de l'olympe...
Humains, trop humains ! - étaient ces dieux si
naïvement façonnés à notre image :
" Si les bœufs, les
chevaux et les lions avaient des mains et pouvaient sculpter des statues,
ils représenteraient les Dieux sous la forme de bœufs de chevaux
et de lions, à la façon des hommes qui les représentent
à leur propre image ... Les Ethiopiens font leurs Dieux noirs avec
un nez camus ; les Thraces disent que les leurs ont les yeux bleus et les
cheveux rouges... " [N3]
Cette idée traversera les temps.
Montesquieu l’appliquera…
aux triangles !
" Si les triangles
faisaient un dieu, ils lui donneraient trois côtés. "
Montaigne ironisera :
" L’homme est bien insensé. Il ne saurait forger un ciron [un minuscule insecte], et forge des Dieux à douzaines. "
Et Voltaire la résumera par sa fameuse formule :
" Si Dieu a créé
l’homme à son image, l’homme le lui a bien rendu. "
Ainsi, la diversité des dieux pourrait-elle
n’être que le reflet de la diversité des facettes de la nature
humaine :
Les dieux des Aztèques exigeaient des sacrifices
humains [N4] ;
En d’autres lieux, les dieux demandaient des orgies
de la pleine lune [N5] ;
Ailleurs encore, ils recommandaient au contraire l’abstinence
sexuelle [N6]...
Des portraits jaunis.

Le dieu de Moïse et d'Abraham est à l'image de ses modèles,
les hommes primitifs des temps de la Bible, forgés par la cruauté
de ces âges sauvages. La violence hostile de la nature, dont aucune
technique ne permettait de se protéger, rendait les hommes d'alors
naturellement rudes. Ils ont donc naturellement prêté
un peu de leur rudesse à
leurs dieux - aussi bien aux dieux d'Homère qu'au dieu de la Bible.
C'est ainsi que le dieu de la Bible est un mélange de Mr. Hyde et de doctor Jekyll ; il fut responsable du premier génocide
connu, le déluge universel ; le Tribunal Pénal International n'avait pas encore été inventé, et l’affaire fut classée sans suite. C’est ce même Dieu qui inventa la vendetta, “ lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération ” (Les Nombres, 14, 18) ; vendetta qui poursuit encore tous les descendants du clan Adam, accablés de maladies,
de tremblements de terre, d'inondations, etc, pour laver un affront perdu
dans la nuit des temps - une vague histoire de pomme, de femme, et de serpent ; et enfin, ce dieu
vengeur punit ses ennemis par les supplices éternels de l'enfer.
Mais le temps a passé. Les hommes civilisés
considèrent aujourd'hui que la vendetta et la torture, comme la
vitesse, c'est dépassé. Nous nous reconnaissons de
moins en moins dans les anciens portraits jaunis de nos dieux ; peut-être
le temps est-il venu de les retoucher, d'en effacer les traits durs et
grossiers, de les adoucir, de les rendre plus humains... plus ressemblants
en quelque sorte.
[N7]
Héraclite.
L’obscur.
Il ne nous est resté que très peu de choses
de l’œuvre d’Héraclite : quelques fragments, de quelques lignes
chacun ; des fragments courts, et souvent obscurs. Socrate
en aurait dit : "
Ce qu’on en comprend est exceptionnel, et je présume donc que le
reste l’est également ". C’est dans
cette obscurité, peut-être voulue [N8], qu’il faut peut-être
chercher une partie de l’immense succès de ces fragments, si abondamment commentés et contre-commentés tout
au long des siècles ; dans cette obscurité propice, les commentateurs
pouvaient en effet faire dire aux textes tout ce qu’ils souhaitaient... Quelques thèmes toutefois en ressortent.
Le feu.
Comme les milésiens, Héraclite a recherché
le principe originel de toutes choses ; pour lui, c’est le feu :
" Toutes choses sont
échangées contre le feu et le feu contre toutes choses, de
même que les marchandises sont échangées contre de
l’or et l’or contre des marchandises. "
(Fragment 90)
Le projet milésien de trouver le principe
unique à partir duquel on pourrait tout construire, nous paraît
peut-être un beau rêve irréaliste, comme on pouvait
en faire à ces époques, encore inconscientes de la complexité de la réalité.
Pourtant, la grande surprise est que... ce principe
unique a enfin été découvert au XXe
siècle - c’est l’énergie - comme l'explique Heisenberg, l’un des pères de la mécanique quantique :
" Nous pouvons faire
remarquer ici que la physique moderne est, à un certain point de
vue, très proche des doctrines d’Héraclite : si nous remplaçons
le mot "feu" par le mot "énergie", nous pouvons presque répéter
ses paroles mot pour mot. En fait, l’énergie est la substance dont
sont faites toutes les particules élémentaires, tous les
atomes et, par conséquent, toutes choses ; et l’énergie est
ce qui fait mouvoir. L’énergie est une substance puisque sa quantité
totale ne change pas, et les particules élémentaires peuvent
effectivement être produites à partir de cette substance,
comme le montrent de nombreuses expériences sur la création
de particules élémentaires. L’énergie peut se changer
en mouvement, en chaleur, en lumière, en électricité.
L’énergie peut être appelée la cause fondamentale de
tous les changements dans le monde. " [N10](Physique
et philosophie).
" Polémos est père
et roi de toutes choses. "
Mais le feu, s’il est à l’origine de toute chose, n’est pas maître du monde, heureusement sans doute ; son pouvoir est contesté par son ennemi juré, l'eau. Il en résulte une lutte universelle, sans vainqueur ni vaincu ; l’eau éteint le feu ; mais le feu du soleil riposte en asséchant la flaque d’eau.
Pour Héraclite, cette lutte de l’eau et du feu est le symbole de ce qui se passe partout dans la nature, sans que nous en soyons conscients. Nous voyons un arc, et nous ne prenons pas garde que sa courbe harmonieuse résulte de la
lutte silencieuse qui oppose le bois à la corde tendue. Et il en est de même pour toute chose ; l’équilibre de l’univers résulte d’une guerre universelle, perpétuelle, cosmique, qui oppose partout et toujours les contraires : eau contre feu, jour contre nuit, hier contre demain, justice contre injustice, et ainsi de suite.
Une guerre qui ne se traduit pas par le chaos et la dévastation ; bien au contraire, puisque c’est elle qui révèle la valeur de chaque chose par contraste avec son contraire ; le printemps nous réveille et nous enchante, par contraste avec l'hiver qui nous avait engourdis ; la lumière du jour nous réjouit d’autant plus que nous connaissons l’obscurité inquiétante de la nuit ; nous goûtons mieux le calme et la tiédeur du soir après l’agitation et la fournaise du jour. En outre, cet affrontement perpétuel du jour et de la nuit n’engendre pas un néant gris et définitif comme on pourrait le craindre en pensant au mélange du blanc et du noir ; cet affrontement est fécond au contraire, puisqu’il en naît le pouls du monde - le temps - qui bat majestueusement le rythme des jours et des saisons.
La guerre, la guerre nécessaire, façonne le monde ; le façonne harmonieusement :
" Polémos (le combat) est père et roi de toutes choses. "
" Ce qui s’oppose à soi est en même temps ajustement à soi, comme les tensions opposées de l’arc et de la lyre. "
De cet affrontement des contraires il résulte une paix apparente, qui masque en réalité une instabilité universelle. Il n’y a rien d’éternel ; les êtres et les choses naissent, font trois petits tours, et puis s’en vont à jamais pour être remplacés par d’autres êtres, d’autres choses ; tout est fuyant ; " Tout coule " (Panta reï), disait Héraclite. Ou encore : " On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve " ; car la seconde fois, ce n’est plus le même fleuve, puisque l’eau du premier jour a été chassée par une eau nouvelle ; et moi-même, je suis également devenu différent de ce que j'étais lors de mon premier bain, puisque le temps, inexorablement, me transforme et m’emporte.
L’équilibre de la terreur.
Avec plus de deux millénaires d’avance, Héraclite
venait d’inventer la guerre froide et l’équilibre de la terreur !
La paix du monde est trompeuse ; c’est une paix armée,
résultant de l’affrontement équilibré de forces qui
s’annihilent.
C’est l’immobilité trompeuse de
deux lutteurs de bras de fer, trahie par un léger tremblement, le
blanc des jointures, la sueur qui perle au front, le rictus qui tord les
bouches, qui sont autant de signes dénonçant au contraire la volonté
tendue, l’effort extrême, la lutte implacable.
Même la paix champêtre de la prairie est
trompeuse, car elle est en réalité la somme d’innombrables
tragédies minuscules. Les herbes ondulent mollement sous la brise
tiède du soir d’été ; tout respire le calme et la
sérénité. Pourtant, derrière chaque brin d’herbe,
derrière chaque petite fleur, des guets-apens se trament, des combats
sans merci se déroulent, et chacun dévore son voisin.
Car la vie, c’est la guerre. L’admirable adaptation
des formes vivantes, la nage des poissons, le vol des oiseaux, la course
des gazelles, tout cela résulte de la lutte implacable pour la
vie, des combats incessants qui font évoluer les espèces
en sélectionnant les individus les plus aptes.
La nature inanimée elle-même est modelée
par la guerre. La courbe harmonieuse de la plage, le long des golfes clairs, semble avoir été
dessinée par un génial paysagiste. En réalité,
c’est la guerre qui a façonné cet arc parfait ; il est né
dans le fracas des tempêtes, le tourbillon des embruns, les hurlements
du vent, car il est la ligne de front qui sépare deux puissances
qui s’opposent rageusement depuis des millénaires : c’est là
que Poséidon l’océan, et Gaïa la terre s’affrontent.
C’est là que les flots attaquent la falaise, inlassablement, vague
après vague, jusqu’à ce qu’elle s’écroule ; c’est
là aussi que la terre résiste, et contre-attaque en comblant
patiemment les anses les plus profondes.
La bonne marche des démocraties modernes résulte
aussi de l’affrontement, entre une majorité et une opposition critique.
L’ensemble des lois et des règles de nos sociétés
est ainsi constitué de strates alternées laissées
par la succession de pouvoirs opposés ; au fil du temps, ces strates
s’empilent et se fondent peu à peu en un socle plus ou moins homogène,
synthèse de tous les courants contradictoires qui traversent la
société.
Parfois même, les sensibilités contraires
exercent ensemble un pouvoir contradictoire. C’est le cas de la France,
et de ses périodes de cohabitation entre un président et
un gouvernement de tendances opposées. Après avoir prudemment
goûté à cette étrange mixture, les Français
semblent y avoir pris goût, comme s’ils étaient rassurés,
pensant qu’ainsi les excès éventuels des uns seraient tempérés
par la résistance des autres... comme la tension opposée
de l’arc et de la corde de l’arc.
A l’inverse, c’est pour avoir refusé la critique
et l’opposition [N11] que les régimes
soviétiques ont sombré. De la même façon, le
gâchis en Afrique aujourd’hui résulte en partie du maintien
de dictatures incapables d’évoluer et de s’adapter, par absence
de critique.
Et enfin, l’opposition, la contradiction, ne sont-elles
pas les conditions nécessaires pour bâtir une personnalité
solide et ouverte, pour bâtir un sain esprit critique ? L’enseignement
d’une pensée unique conduit à la fermeture de l’esprit au
mieux, au fanatisme au pire. L’exemple des "jeunesses machins" est instructif
à cet égard, qu’il s’agisse des jeunesses staliniennes, ou
hitlériennes, ou, bien avant elles, de la jeunesse du Moyen Age,
endoctrinée dès le berceau.
Montaigne avait noté qu’il est bon de "
frotter sa cervelle contre icelle d’autrui ".
(...)
Parménide et le "traumatisme éléatique"
(...)
Empédocle
(...)
Anaxagore.
 Comme Empédocle, Anaxagore tentera de résoudre le problème du changement au moyen
d’un mécanisme de mélange. Comment l’herbe
peut-elle devenir la chair du lapin qui la mange ? Pour Anaxagore, c'est parce qu'il
y a déjà dans l’herbe d’infimes particules de viande
de lapin. C.Q.F.D. On y trouve également des particules de
viande de vache, puisque la même herbe, mangée par une vache devient
de la viande de vache ; elle contient également des particules de
lait, puisque la vache tire son lait de cette herbe qu’elle mange ; et
ainsi de suite.
Comme Empédocle, Anaxagore tentera de résoudre le problème du changement au moyen
d’un mécanisme de mélange. Comment l’herbe
peut-elle devenir la chair du lapin qui la mange ? Pour Anaxagore, c'est parce qu'il
y a déjà dans l’herbe d’infimes particules de viande
de lapin. C.Q.F.D. On y trouve également des particules de
viande de vache, puisque la même herbe, mangée par une vache devient
de la viande de vache ; elle contient également des particules de
lait, puisque la vache tire son lait de cette herbe qu’elle mange ; et
ainsi de suite."Herbe tu étais, herbe tu retourneras !" disent gravement les vieux lapins qui savent, aux jeunes petits lapins…
L’invention de Dieu.
Il restait toutefois à expliquer pourquoi le
changement est ordonné. Pourquoi les mêmes changements se
reproduisent-ils jour après jour, saison après saison, sans
surprise ; l’herbe se transforme en lapin, ou en mouton, mais jamais en
un animal moitié lapin - moitié mouton ; pourquoi ? D’où
vient cet ordre ?
En résumé, Anaxagore avait résolu
le problème du hardware, celui de la transformation de l’herbe
en viande de lapin. Mais il lui restait à résoudre le problème
du software, à expliquer que cette viande s’ordonne en un
organisme aussi cohérent qu’un lapin en parfait état de marche.
Le software, ce n’est rien, puisque ce n’est que
de l’intelligence, information immatérielle qui ne se voit pas,
qui ne pèse rien, qui se copie et se recopie, qui se transmet instantanément
via l’éther... et qui peut même être effacée
et anéantie à tout jamais [N12]
! Mais le software, c’est aussi tout, puisque c’est cette intelligence-là
qui donne vie au matériel, qui l’anime (littéralement : qui
lui donne une âme !), qui en oriente le fonctionnement vers un but,
au lieu qu’il tourne en rond en un vain mouvement perpétuel.
Pour résoudre ce difficile problème, Anaxagore
en fut réduit à faire appel, sans préciser davantage,
au
Noüs, c’est-à-dire à quelque chose qui peut
se traduire par intellect, ou esprit, pensée, sagesse, intention,
âme, désir, volonté... Quelle que soit la traduction la plus fidèle, Anaxagore semble bien avoir été le premier
à faire intervenir un "intellect", un "esprit", qui n’est pas
la matière, mais qui "commande" cette matière, qui en
dirige les transformations, autorisant les unes, interdisant les autres.
Un esprit qui commande la matière et qui en
explique l’ordre ? Anaxagore venait tout simplement d’inventer dieu [N13]-[N14] !
Le portrait robot du Noüs-Dieu.
L’invention était géniale.
L’idée était toutefois encore vague, il fallait la préciser. Il fut décidé d’établir un portrait-robot et de le diffuser le plus largement possible dans le public. Les iconoclastes ne furent pas d’accord avec cette idée de portrait, fût-il robot ; les musulmans également sont contre.
Patiemment, les enquêteurs ont réuni les
indices. Ils ont scruté l’univers, et l’ont mis sur table d’écoute, apprenant à
décoder ses murmures, à y reconnaître son premier cri
- le big bang - ses premiers pas hésitants, ses premiers atomes,
ses premières étoiles et galaxies, puis enfin les planètes,
les bactéries, l’herbe et les lapins. Sur des kilomètres
d'enregistrement ils ont découvert les petits et grands secrets
de l'univers. Mais à leur grande surprise, le Noüs n'apparaissait
jamais sur ces bandes ; comme si l'univers se débrouillait tout
seul, et que de simples mécanismes physiques suffisaient à
en expliquer l'ordre.
Les enquêteurs ont ainsi découvert l’impressionnante
machinerie qui fait tourner les étoiles dans le ciel ; et pas de
Noüs ; " Sire,
je n’ai pas besoin de cette hypothèse "
répondra Laplace à Napoléon, qui l’interrogeait sur
le rôle de Dieu dans sa théorie du système solaire.
 Ils ont découvert la chimie, qui réalise
l’étonnante transformation de l’herbe en viande de lapin.
Ils ont découvert la chimie, qui réalise
l’étonnante transformation de l’herbe en viande de lapin.
Ils ont découvert l'évolution, qui explique
la possible émergence de la vie à partir de la matière
inerte, sa lente évolution, sa complexification jusqu’à la
naissance de l'herbe, des lapins, et de la conscience.
La matière-hardware n’aurait-elle donc aucun besoin
de Noüs-software pour s’organiser ? Est-il possible qu’en
laissant tourner follement la machine-matière, sans autre software
que les lois de la matière et du hasard, est-il vraiment possible que se forme alors naturellement,
au terme d’une histoire incroyablement vaste dans le temps et dans l’espace,
l’univers que nous connaissons ? Avec la vie, chaude et palpitante... mais
aussi avec la souffrance aveugle, injuste, révoltante - et la mort
!
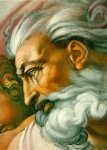 La souffrance est un indice troublant qui embarrasse
beaucoup d’enquêteurs. S’il n’existe en effet que la matière-hardware
et le hasard - alors cette souffrance n’a rien de surprenant, elle résulte
naturellement des tâtonnements aveugles du hasard. Si au contraire
il existe un esprit créateur de toutes choses, intelligence de la
matière, software de l’univers, comment comprendre alors que cet
esprit dont tout procède ait créé ou toléré
la souffrance et l’injustice ?
La souffrance est un indice troublant qui embarrasse
beaucoup d’enquêteurs. S’il n’existe en effet que la matière-hardware
et le hasard - alors cette souffrance n’a rien de surprenant, elle résulte
naturellement des tâtonnements aveugles du hasard. Si au contraire
il existe un esprit créateur de toutes choses, intelligence de la
matière, software de l’univers, comment comprendre alors que cet
esprit dont tout procède ait créé ou toléré
la souffrance et l’injustice ?
Après deux millénaires d’enquête,
le portrait-robot du Noüs est encore flou et imprécis ; on n’en devine que quelques traits incertains, et troublants :
il laisse le monde tourner sans lui - plus ou moins rond ;
il est indifférent, ou impuissant, devant la
souffrance ;
et enfin, il est d’une absolue discrétion objective.
|
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L’herbe et le lapin
C’était un petit lapin aux yeux bleus.
Il aimait,
d’un amour tendre comme l’herbe des prés.
Il partit lui offrir un bouquet d’herbes sauvages.
Mais elle lui avait posé un lapin.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
|
Faisons le point.
Deux équipes s’affrontent.
D’un côté, l’équipe d’Élée - capitaine Parménide.
Sponsorisée par l’être.
Sa devise, en noir sur les maillots : " Ce qui est, est. "
De l’autre côté, l’équipe d’Éphèse - capitaine Héraclite.
Sponsorisée par le mouvement.
Sa devise : " tout coule. "
La partie est intéressante, avec de beaux gestes techniques de part et d’autre. Mais un peu décevante sur le plan du résultat ; un coup d’œil au panneau d’affichage montre qu’aucun but décisif n’a encore été marqué :
Élée (Parménide) |
0 |
Éphèse (Héraclite) |
0 |
Les chroniqueurs s’enflamment, annonçant déjà que l’on s’achemine vers l’insoutenable séance de tirs au buts ; le suspens est maximum.
C’est alors que Démocrite vint.
" La menue monnaie de l’univers. "
L’être est ; en théorie ; immobile et éternel, homogène, continu, et rond.
Le mouvement est ; c'est le tourbillon de la vie, où chacun pour soit repart en chantant.
Match nul, zéro partout. Comment concilier ces deux exigences contradictoires de permanence et de changement ?
Démocrite a trouvé la solution : il suffit de démultiplier l’unique sphère de Parménide, et de l’éclater en une infinité de sphères immuables.
Démocrite venait d’inventer les atomes !
A partir de là, tout s’explique. Les atomes sont éternels ; voilà ce qui est, et ne se perd jamais. Mais les atomes, il en existe de différentes sortes, se combinent entre eux ; ils sont en quelque sorte la "
menue monnaie de l’univers ", avec laquelle, par des combinaisons sans fin, on peut acheter, vendre, échanger l’infinie variété des substances de l’univers. Voilà d'où vient le changement. L’univers est un immense "Meccano", dont les pièces élémentaires sont les atomes : en puisant dans sa grande boîte d'atomes, Démocrite pouvait construire aussi bien une maison, qu’une voiture ou un cheval.
Héraclite et Parménide vont pouvoir se quitter sur un match nul honorable, en se serrant sportivement la main ; ils avaient tous deux raison.
Parménide avait raison ; lors d’un changement, lors d’une réaction chimique par exemple, rien ne change ; on retrouve en fin de réaction les mêmes atomes qui y étaient présents dès le début.
Ce qui est, est !
Mais en même temps, Héraclite avait raison ; tout change, puisque les substances initiales disparaissent, laissant place à de nouvelles substances.
Tout change ! Panta reï.
De l’atome à la vie.
Comment passe-t-on des atomes, infiniment petits et donc invisibles, aux objets que nous connaissons ? Pour répondre à cette question, Démocrite inventera une recette toute simple :
° Prenez un vide, très grand ;[N15]
° prenez des atomes, très nombreux ;
° ajoutez une pincée de tourbillon chaotique - très important, tout le secret est là ;
° laissez agir le temps et le hasard.
Démocrite imaginera ainsi une pluie d’atomes tombant éternellement dans le vide en tourbillonnant ; du fait des tourbillons, les atomes se heurtent, et se lient alors les uns aux autres pour former les objets du monde, ou au contraire ils se dispersent sous la force des chocs... Ainsi, les choses - le ciel, la terre, vous, moi - naissent et disparaissent naturellement à la suite des chocs que subissent au hasard les atomes. C’était une conception révolutionnaire, qui se distinguait radicalement des solutions d’Empédocle ou d’Anaxagore, puisqu’elle ne faisait appel à aucun esprit, à aucun principe immatériel, tel que l’amitié, la haine, ou l’intelligence ; il n’y avait que des atomes, dont l’agitation désordonnée, au hasard, était cause mécanique de toute chose.
(...)
(...)
Retour
à la page d'accueil :
 |
Retour en haut de page :
|

NOTES:
[N1] : Alias Bacchus.
[N2] : Sur la côte
d’Asie Mineure, province grecque d’Ionie à cette époque ;
en Turquie actuellement.
[N3] : Les musulmans,
en interdisant toute représentation de Dieu, ne sont pas tombés
dans ce piège !
[N4] : La cruauté,
hélas, est une composante de la nature humaine.
[N5] : Attention,
ce n’était pas, seulement, pour le plaisir !
Ceci se passait au temps où les hommes croyaient
que la vie était le résultat de l’union du ciel et de la
terre ; car ils voyaient la terre s’offrir aux nuages du ciel, descendus
vers elle pour la caresser, l’arroser de leur pluie fertile, et donner
vie aux innombrables graines qui sommeillaient en son sein ; elles germaient
alors, éventrant la terre pour lancer leurs jeunes pousses vers
le ciel de lumière - leur père.
En ces temps-là, Hésiode célébrait
" la terre, la toute belle aux seins épanouis... "
Ces orgies avaient ainsi une fonction bien précise
: il s’agissait de donner le bon exemple au ciel et à la terre -
pour qu’ils persévèrent dans leurs si fructueuses relations
!
[N6] : L’orgie avait
une certaine logique, on vient de le voir. La logique de l’abstinence
sexuelle est bien moins claire ; en fait, de toutes les perversions sexuelles, l’abstinence est bien la plus étonnante et la plus incompréhensible. Elle résulterait de cette idée,
fort peu logique, selon laquelle ce qui est agréable serait à
proscrire !
Cette logique-là, si elle ne fait pas partie
de la nature humaine, fait partie de notre culture.
[N7] : La mode actuelle
des spiritualités orientales tient peut-être, en partie, à
leur côté plus "soft", contrastant avec une Bible parfois
imprécatoire.
On préfère aujourd’hui les couleurs
pastel, les drapés safran souples, aux austères robes noires.
[N8] : Héraclite était un aristocrate, et un intellectuel ; il était donc peut-être un " snob au carré " , peu soucieux d’être aisément compris des autres.
[N10] : Le chapitre
sur la mécanique quantique précise les phénomènes
auxquels il est fait allusion dans cette citation.
[N11] : pour l’avoir
parfois exterminée.
[N12] : Ceux qui
ont un jour "perdu" les fichiers-système de leur ordinateur, savent
combien le software-intelligence peut facilement s’évanouir, nous
laissant devant un hardware devenu inerte et inutile, vaine matière
insensée.
[N13] : Il s’agit
ici de l’invention d’un dieu de philosophe, en tant que résultat
d’une réflexion rationnelle - et non du Dieu de religion que Moïse
avait inventé plusieurs siècles auparavant.
[N14] : Les hommes sont imprévisibles et ingrats : ils mirent l’inventeur
de Dieu en examen… pour impiété ! un comble. Anaxagore avait
en effet osé affirmer que la lune n’était qu’une pierre,
et non une déesse ! Pourchassé, il dut fuir Athènes en trirème.
Il est évident que l’humanité a progressé
depuis ces anciens temps… nous avons mieux que des trirèmes.
[N15] : Il fallait donc en quelque sorte "inventer" le vide - dont Parménide avait nié l’existence.
I. Introduction.
II. Les personnages.
III. Les premiers philosophes, les "Présocratiques".
Les milésiens, philosophes de la nature.
La fin des mythes ?
Le changement, l'être, l'esprit, l'atome et le hasard.
IV. La période classique.
Les Sophistes - Socrate - Platon.
Les sophistes.
Platon
Aristote.
Aristote, Platon, Parménide, et les autres.
Le monde d'Aristote.
L'influence d'Aristote.
V. La période hellénistique et romaine.
Et le bonheur dans tout ça ?
Epicure.
Le stoïcisme.
Le doute et la pose.
VI. Le Moyen Age.
Saint Augustin.
La prédestination.
La souffrance.
Sans limites ?
La Grande Coupure.
Après l'an mille.
Le Moyen Age n'est pas mort.
VII. Un nouveau monde.
Des hommes nouveaux dans un nouveau monde.
L'héliocentrisme - la naissance de la physique
classique.
La révolution copernicienne.
Copernic - Kepler.
Galilée. [lire
des extraits]
Le vrai débat.
Le principe d'inertie.
Newton.
L'univers est-il infini ?
Einstein.
La révolution mécaniste du XVIIe siècle.
Une révolution culturelle.
Nous, les machines ?
VIII. Enfin l'incertain fut !
Un enfant étonnant et contestataire.
Le décodage des Ecritures.
L'apprenti-sorcier.
La fin des certitudes ?
L'incertain débusqué.
Nostalgie de l'illusion.
Orphelin de certitudes.
Le théorème de Dieu.
De l'illusion à la violence.
IX. De Galilée à Darwin.
Rationalistes et empiristes.
Descartes.
La métaphysique classique.
Les empiristes - Hume.
Kant
X. La nature se dévoile.
L'évolution des espèces - Darwin.
La matière et la vie.
La chimie de la vie.
La vie de la vie. [lire des extraits]
La génération spontanée, ou la
vie de la matière.
L'homme descend du singe !
Le point sur la théorie.
Les créationnistes : le Moyen Age bouge encore
!
Hasard contre intelligence.
Entre la bête et l'ange - l'homme évolué.
La physique moderne.
La relativité - Einstein.
Le big bang.
La découverte du big bang.
[lire des extraits]
La colonisation du big bang - Questions de temps !
La mécanique quantique.
" Aucun phénomène n'est réel
tant qu'il n'est pas observé. "
Le hasard dans la science !
[lire des extraits]
La colonisation de la mécanique quantique -
Les mythes sont de retour !
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien
?
[lire des extraits]
La machine humaine ?
XI. Et le monde fut.
Matière ou esprit ?
L'univers esprit.
Une réponse... qui pose des questions !
Un créateur discret et paresseux.
Foi et raison.
L'univers matière.
La création et la créature.
Le monde imparfait.
La multitude.
Le bon vieux temps… c'est aujourd'hui !
L'homme ancien - La bête humaine.
(400 pages environ.)

Retour
à la page d'accueil :
 |
Retour en haut de page :
|
zarblub



 Xénophane, qui avait
été une sorte de barde, de troubadour, chantant les poèmes
d’Homère et d’Hésiode dans les banquets, avait en effet pris
conscience des difficultés que soulevait le comportement de ces
dieux, qui se permettaient tout ce qui est blâmé chez les
hommes : mentir, boire à l’excès, forniquer à tout
va, (surtout Zeus, chef des dieux, coureur de jupons en diable, connu pour
être un fin amateur de belles mortelles). Xénophane en avait
conclu que nous investissons une grande part de nous-mêmes dans
nos dieux, imaginant qu’ils ne sont que des sortes de "Superman", semblables
à nous, mais en mode super ; ayant une super-force, des super-joies,
des super-colères, des super-jalousies ; et tout aussi capables que Superman de prendre l'aspect d'un simple mortel, si nécessaire. Les poètes, Homère, Hésiode, étaient
grandement coupables en ce domaine, en colportant les savoureuses histoires
de la vie agitée des dieux - leurs colères, leurs frasques
amoureuses, les coquetteries des belles de l'olympe...
Xénophane, qui avait
été une sorte de barde, de troubadour, chantant les poèmes
d’Homère et d’Hésiode dans les banquets, avait en effet pris
conscience des difficultés que soulevait le comportement de ces
dieux, qui se permettaient tout ce qui est blâmé chez les
hommes : mentir, boire à l’excès, forniquer à tout
va, (surtout Zeus, chef des dieux, coureur de jupons en diable, connu pour
être un fin amateur de belles mortelles). Xénophane en avait
conclu que nous investissons une grande part de nous-mêmes dans
nos dieux, imaginant qu’ils ne sont que des sortes de "Superman", semblables
à nous, mais en mode super ; ayant une super-force, des super-joies,
des super-colères, des super-jalousies ; et tout aussi capables que Superman de prendre l'aspect d'un simple mortel, si nécessaire. Les poètes, Homère, Hésiode, étaient
grandement coupables en ce domaine, en colportant les savoureuses histoires
de la vie agitée des dieux - leurs colères, leurs frasques
amoureuses, les coquetteries des belles de l'olympe...
 Comme Empédocle, Anaxagore tentera de résoudre le problème du changement au moyen
d’un mécanisme de mélange. Comment l’herbe
peut-elle devenir la chair du lapin qui la mange ? Pour Anaxagore, c'est parce qu'il
y a déjà dans l’herbe d’infimes particules de viande
de lapin. C.Q.F.D. On y trouve également des particules de
viande de vache, puisque la même herbe, mangée par une vache devient
de la viande de vache ; elle contient également des particules de
lait, puisque la vache tire son lait de cette herbe qu’elle mange ; et
ainsi de suite.
Comme Empédocle, Anaxagore tentera de résoudre le problème du changement au moyen
d’un mécanisme de mélange. Comment l’herbe
peut-elle devenir la chair du lapin qui la mange ? Pour Anaxagore, c'est parce qu'il
y a déjà dans l’herbe d’infimes particules de viande
de lapin. C.Q.F.D. On y trouve également des particules de
viande de vache, puisque la même herbe, mangée par une vache devient
de la viande de vache ; elle contient également des particules de
lait, puisque la vache tire son lait de cette herbe qu’elle mange ; et
ainsi de suite. Ils ont découvert la chimie, qui réalise
l’étonnante transformation de l’herbe en viande de lapin.
Ils ont découvert la chimie, qui réalise
l’étonnante transformation de l’herbe en viande de lapin.